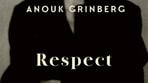Stupeur et tremblements, descendre aux enfers sous le voile de la servitude volontaire
Ce microcosme d’entreprise japonaise, présenté à la manière d’une machine froide et implacable, devient le lieu d’une lutte interne et externe. C’est à travers la lente érosion de son moi, face à la tyrannie des rôles sociaux et des rituels quotidiens, que se cristallise la tragédie subtile de cette œuvre.


Dans l’œuvre incandescente qu’est Stupeur et Tremblements, Amélie Nothomb compose une oeuvre presque dissonante où se mêlent l’aliénation, la fascination et l’humiliation. Le roman devient rapidement une véritable exploration de la dissolution identitaire sous la pression d’un cadre hiérarchique opaque et impénétrable.
L’archéologie de la soumission : un effacement graduel du sujet
Dès les premières pages, Nothomb nous plonge dans un espace désorientant où chaque étage de la tour Yumimoto semble receler un nouveau degré de soumission. Le récit se construit autour d’une pyramide bureaucratique qui n’a rien de fonctionnel, mais qui nous rappelle la machine kafkaïenne : elle ne se contente pas de réguler le travail, elle absorbe et annihile. Dès son entrée dans l’entreprise, la narratrice est confrontée à un enchaînement inexorable de frustrations symboliques, à commencer par cette lettre inoffensive qu’elle doit rédiger en anglais pour M. Saito. Ce moment anodin devient rapidement un tour de force stylistique où chaque rejet successif de son travail par son supérieur est un coup de poignard métaphorique dans l’estime de soi : « Monsieur Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira : Recommencez. » La déchirure répétée des missives successives fait office de métaphore parfaite pour la déconstruction progressive de l’individu.
Ainsi, l’entreprise japonaise, loin d’être un simple lieu de labeur, devient ici une arène sacrificielle où l’individu occidental, empreint de son héritage d’autonomie et de rationalité, est lentement sacrifié sur l’autel des coutumes et des hiérarchies incompréhensibles. Le vertige de la soumission n’est pas seulement subi par la narratrice ; il est cultivé et institutionnalisé. Comme dans un rite initiatique cruel, Amélie doit s’effacer, devenir une sorte de fantôme qui traverse les couloirs de Yumimoto sans jamais vraiment y exister. « Ce fut le premier mot que je prononçai dans la compagnie. Jusque-là, je m'étais contentée d'incliner la tête. »
Fubuki Mori : incarnation hiératique de la beauté sadique
L’un des personnages les plus fascinants de cette fresque est indéniablement Fubuki Mori, figure ambivalente, qui incarne à la fois la grâce impénétrable du Japon et son intransigeance froide. Plus grande qu’un homme, plus belle qu’une déesse, elle apparaît dès sa première apparition comme une créature quasi surnaturelle, une kami moderne investie d’un pouvoir qui dépasse l’entendement de la narratrice. Cependant, sous cette apparence de perfection, se cache une force destructrice qui œuvre à miner les aspirations de la protagoniste. En la dénonçant, Fubuki ne fait pas que trahir une amitié naissante ; elle devient l’agent d’une tradition rigide qui ne tolère ni les écarts, ni les exceptions.
Le personnage de Fubuki ne se limite pas à la simple antagoniste. Non, elle incarne manifestation vivante du système hiérarchique qui broie sous sa beauté glacée…
Chaque sourire, chaque regard, même les gestes de politesse les plus innocents, sont autant de coups infligés à Amélie, qui, fascinée, ne peut s’empêcher de vénérer celle qui la détruit : « Je lui demandai quel était l'idéogramme de son prénom [...] Fubuki signifie "tempête de neige"! ». Ce paradoxe de l’amour-haine envers Fubuki est peut-être la clé de la lecture du roman : la soumission n’est jamais totale sans un certain degré de fascination pour l’autorité qui l’impose. Ce rapport trouble entre les deux femmes reflète la complexité de la dynamique maître-esclave décrite par Hegel, où la reconnaissance du maître par l’esclave est une forme de libération autant que d’asservissement.
Une chute orchestrée : de la servitude volontaire à l’annihilation personnelle
Au fil du récit, Amélie est progressivement dépossédée de toute compétence, de tout rôle significatif. Ce n’est plus seulement la personne qui est niée, mais l’idée même de l’utilité. Le déclin vers des tâches de plus en plus absurdes – faire le café, vérifier des calendriers, des photocopies – s’accompagne d’une forme de renoncement existentiel : « Vous ne vous fatiguez pas trop à cet épuisant exercice ? » – « C'est terrible. Je prends des vitamines. » L’entreprise Yumimoto apparaît alors comme un espace où l’utilité de l’individu n’est pas mesurée par sa compétence ou son travail, mais par son degré d’effacement. Chaque tâche qu’Amélie se voit confier est une marche supplémentaire vers la nullité absolue, une sorte de rituel de purification qui semble la préparer à une disparition totale.
La scène finale, où elle est assignée aux toilettes, symbolise l’aboutissement de ce processus de déshumanisation. Ce qui commence comme une humiliation devient paradoxalement une source d’illumination intérieure pour la narratrice : « Je m'étais attribué une fonction sans demander la permission de mes supérieurs directs. » Par ce geste ultime de soumission, Amélie touche à une forme de transcendance inversée : elle a atteint le degré zéro de l’existence dans le système, et pourtant c’est là qu’elle trouve un espace pour elle-même. L’acceptation de la nullité n’est plus vue comme une défaite, mais comme une délivrance, une manière de survivre au cœur d’un monde qui exige la disparition.
La servitude comme catharsis, le néant comme solution
Amélie Nothomb offre, à travers Stupeur et Tremblements, un portrait acéré d’une société où l’individu n’existe que dans la mesure où il parvient à s’annihiler. Mais au-delà de la simple critique d’un système hiérarchique impitoyable, l’œuvre pose aussi une autre question, celle de la servitude volontaire : doit-on parfois disparaître pour mieux s’affirmer ?
L’entreprise japonaise devient alors le miroir grossissant d’une aliénation plus universelle, car finalement l’effacement permettrait de se réaliser : « Vous vous êtes mise dans une très mauvaise situation. Sortez ! Je ne veux plus vous voir ! ». C’est en ce sens que le roman de Nothomb dépasse le simple témoignage personnel pour devenir une œuvre véritablement philosophique, une exploration de la condition humaine face à des forces qui le dépassent. L’absurdité des tâches, la cruauté des relations de pouvoir, la fascination pour l’autorité oppressive – tout cela résonne avec les grandes œuvres existentialistes du XXe siècle, qu’il s’agisse de Kafka, de Camus ou de Beckett : « Vous avez commis assez de dégâts comme ça ! ».
Force est de constater que Nothomb, avec son éternelle élégance humaine et stylistique, nous confie ici avoir essayé de se conformer à un monde étranger, en y ayant pourtant découvert que la seule manière de survivre est d’embrasser sa propre disparition : « J'appelais cela la sérénité facturière. » Mais dans ce néant, dans cette soumission totale, il reste un éclat de liberté : celui d’accepter l’absurdité et de faire de la défaite une forme de triomphe intérieur.