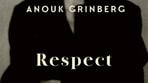Bureau de tabac de Fernando Pessoa : la lucidité comme naufrage
Bureau de tabac de Fernando Pessoa, signé sous l’hétéronyme d’Álvaro de Campos, est un poème qui transforme la conscience de soi en un poids insupportable, universel car commun à tous.tes.


Dès le début, l’affirmation du poème est radicale, tellement radicale qu’elle en ferait trembler le texte :
« Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. »
« Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Aparte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. »
Ce constat abrupt installe d’emblée une tension irréconciliable entre l’aspiration au grandiose et la sensation d’échec absolu, notamment car le poème oscille entre une introspection corrosive et une observation du monde extérieur. Ici, il s’agit de la rue et du bureau de tabac, un miroir impitoyable de la réalité qui, au dehors, se déroule seule. Cette opposition entre l’immobilité intérieure et l’agitation extérieure constitue le cœur du texte et des préoccupations de la voix poétique.
Alors, Pessoa excelle dans l’art de sonder les tréfonds de l’individu moderne, perdu entre la contemplation et l’inaction, reflet même de cette contemplation. La rue, décrite avec une précision clinique, est traversée d’une humanité indifférente et mécanique :
« Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel, / Sur une rue inaccessible à toutes pensées, / Réelle, au-delà du possible, certaine, au-delà du secret. »
« Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, / Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, / Real, impossívelmente real, certa, desconhecidamente certa. »
L’extérieur apparaît comme une surface froide et indifférente, en contraste violent avec l’intensité intérieure du locuteur. Chaque mouvement du monde semble le renvoyer à son propre vide, à son incapacité d’agir. La lucidité devient alors un poison, une clarté insupportable qui le paralyse :
« Aujourd’hui je suis vaincu, comme si je savais la vérité. / Aujourd’hui je suis lucide, comme si j’allais mourir. »
« Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. / Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. »
L’échec est omniprésent, sans être le fruit d’une tentative manquée, mais d’un refus de l’action, d’une incapacité chronique à se projeter dans le monde. L’auteur pousse cette idée jusqu’à l’absurde :
« J’ai tout raté. / Comme je n’ai fait aucun projet, ce tout n’était peut-être rien. »
« Falhei em tudo. / Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. »
La conscience est exacerbée, alerte du décalage entre le rêve et la réalité. Le poète se compare avec une ironie amère à Napoléon et au Christ, suggérant que les ambitions les plus grandioses ne sont que des chimères si elles ne s’incarnent pas dans l’action :
« J’ai rêvé plus que Napoléon n’a conquis. / J’ai serré sur mon cœur hypothétique plus d’humanités que le Christ. »
« Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. / Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. »
Toutefois, cette lucidité ne débouche sur aucun dépassement ; le texte est cyclique, il enferme le locuteur dans un vertige d’autodérision et de renoncement. Ce rapport au monde, marqué par un scepticisme total, est traversé par des éclats de révolte vite éteints :
« Le monde est à celui qui naît pour le conquérir / Et non à celui qui rêve qu’il peut le conquérir, même s’il a raison. »
« O mundo é para quem nasce para o conquistar / E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. »
La voix poétique dissèque alors l’impuissance humaine avec une précision chirurgicale. Espoirs et projections sont immédiatement annihilés, illusions condamnées. De fait, l’image du masque, collé au visage et qu’il est impossible d’arracher, illustre ce dilemme existentiel :
« Quand j’ai voulu arracher ce masque, / Il collait au visage. / L’ayant retiré, je me suis regardé dans la glace, / J’étais déjà vieux. »
« Quando quis tirar a máscara, / Estava pegada à cara. / Quando a tirei e me vi ao espelho, / Já tinha envelhecido. »
Face à ce naufrage intérieur, le réel continue de se dérouler avec une indifférence cruelle. Le patron du bureau de tabac et Estève, figure de l’homme simple, deviennent les contrepoints d’une vie où l’absence de métaphysique est une forme de salut :
« Mais je le connais : c’est Estève-n’a-pas-de-métaphysique. »
« Ah, conheço-o : é o Esteves sem metafísica. »
Le sourire du patron du tabac, qui clôt le poème, incarne cette banalité triomphante face aux tourments existentiels du poète. Ce sourire est celui d’une réalité qui persiste, imperturbable, face aux déchirements intérieurs.
« Et le patron du Tabac a souri. »
« E o Dono da Tabacaria sorriu. »
Bureau de tabac fait l’effet d’une descente vertigineuse dans l’abîme de la conscience, la poésie devenant similaire à un coup porté à l’illusion de l’identité. Pessoa, à travers Álvaro de Campos, donne voix à la tragédie du rêveur lucide, pris au piège de son propre esprit et incapable de se fondre dans le mouvement du monde. Ce texte, d’une modernité brutale, résonne comme une confession universelle de l’échec et du doute.